Hector Placide Giat raconte son combat avec le tigre
 Carte postale sur mesure envoyée par un admirateur de Giat
Carte postale sur mesure envoyée par un admirateur de Giat
Donc, depuis deux ans, je dirigeais l'école d'arrondissement de Baria. Le 28 octobre 1893, à huit heures du matin, les notables de Long-hu'o'ng, affolés, accourent à l'école en criant : « Monsieur! Monsieur! Au secours! Le tigre est dans nos maisons! ». Je quitte aussitôt ma classe, je saute sur mon fusil et je pars au galop.
C'était vrai. Un tigre, au cœur même du village, venait d'enlever un cochon. Il s'était caché dans un petit champ de cannes à sucre, entre trois sentiers très fréquentés, à quelques pas de la grand'route qui traverse Baria.
Je fais reculer les Annamites qui m'accompagnent et, seul, je fais le tour du champ.
Le tigre m'aperçoit, quitte son abri et fond sur moi à découvert… Je pouvais me sauver encore. Mais les Annamites me regardaient, je fis face, et laissant l'animal venir à deux pas de moi, je lui tirai dans la tête un premier coup de feu qui le fit trébucher et lui creva un œil. Un second coup de fusil, tiré à bout portant, lui fracassa la mâchoire. Couvert de sang, poussant des rugissements effroyables, le tigre fît un bond et enleva d'un coup de griffe le fusil que je lui présentais. A ce moment je me retourne et, réunissant toutes mes forces, je lance au tigre un vigoureux coup de pied. C'est ce qui me sauva. Le tigre en effet ne tue pas avec ses dents, qu'il a pourtant formidables : il donne la mort avec ses griffes. Quand il s'agit de proie humaine, il commence par ouvrir le ventre; plus rarement il déchire le cou. Le coup de pied que, dans un dernier effort j'avais lancé au tigre, l'atteignit au mufle. Avec la rapidité de l'éclair, l'animal saisit mon pied dans ses griffes, et l'enfonça dans sa gueule en broyant les os.
Alors je tombai sur le dos, mais sans pousser un cri, sans perdre connaissance. Le tigre s'accroupit et me déchira les chairs de la jambe, lentement, en rugissant et en attirant peu à peu sous lui la partie déjà dévorée. Un des os métatarsiens fut retrouvé entre le péroné et le tibia!
Les Annamites, épouvantés, s'étaient pourtant peu à peu rapprochés à une vingtaine de pas. Ils poussaient des cris, frappaient des mains, mais n'avançaient pas.
Comme je parle très couramment l'Annamite, je les exhortai au courage. Je leur rappelai que ma femme les avait souvent soignés et guéris, je leur parlai de mes petits enfants, qui leur reprocheraient leur lâcheté, je leur promis une forte somme d'argent, puis je tirai de ma cartouchière deux cartouches que je lançai auprès d'eux en leur disant de ramasser mon fusil! Mais le tigre leur fit trop peur.
Ma jambe était maintenant dévorée jusqu'au genou. Dans sa gueule toute ensanglantée, le tigre croquait ma rotule qu'il avait déboîtée; ses griffes labouraient déjà la cuisse : la mort allait venir avec le coup de « banderole » en travers du ventre. Alors, me voyant abandonné, je voulus du moins mourir en combattant.
Dégageant brusquement ma jambe gauche intacte jusqu'alors, je frappai, à coups de pied dans les flancs, à coups de poing dans la tête, le tigre qui était presque accroupi sur moi. C'est en me défendant ainsi que je fus blessé à la jambe gauche, mais je n'en continuai pas moins à frapper de toutes mes forces.
Soit pour cette cause, soit parce que l'animal souffrait trop des coups de feu qu'il avait reçu il se redressa tout à coup, rugit une dernière fois en fixant sa victime, et retourna dans le champ de cannes à sucre. Il était resté plus de dix minutes sur moi.
Il fut achevé le soir. On retrouva dans sa tête les chevrotines que j'y avais logées, mais le crâne était intact.
Les Annamites me laissèrent sur le dos, n'osant approcher. Cinq minutes après j'appelai l'un d'eux, je lui nouai mes bras autour du cou, et me fis transporter à l'école. Les Européens étaient accourus. On m'étendit sur un matelas et l'on me fit un pansement sommaire. Mon sang-froid ne m'avait pas abandonné. Je rédigeai moi-même les dépêches à envoyer à ma femme, qui était alors au Cap Saint Jacques près d'accoucher, et à mes chefs. Je donnai les ordres les plus minutieux pour la remise de mon service, je pris les quelques dispositions que la probabilité de ma mort commandait, et j'attendis patiemment, en causant et parfois même en plaisantant, que la chaloupe demandée à Saigon par l'Administrateur vienne me prendre; elle arriva vers minuit. On m'embarqua, et le lendemain vers dix heures du matin, j'arrivais à l'hôpital militaire. Les plaies, horribles à voir, étaient infectées par la gangrène et la bave du tigre; les artères sortaient, les os étaient dénudés.
L'amputation fut faite, au tiers inférieur de la cuisse, par M.Hénaff, remplaçant le médecin chef absent. Cette amputation ne fut pas heureuse. De la chair mâchurée avait été laissée dans la cicatrice; le fémur avait été coupé trop long, et une fissure du périoste s'allongeait, presque invisible, sur une longueur de plusieurs centimètres. Malgré cela, et contre les prévisions des médecins, je ne mourus pas, mais j'endurai pendant 45 jours les plus épouvantables souffrances. Plus d'une fois j'appelai la mort à grands cris.
Le 45ème jour le fémur déchira la cicatrice et fit brusquement saillie au dehors: nouvelle opération. On coupa cette fois 8 millimètres d'os, et on referma la plaie. Les points de suture échappèrent, mais la guérison semblait encore possible. La douleur ayant cessé, l'appétit revint. Le médecin m'autorisa à manger « tout ce que je voulais »… Et alors, en avant les légumes! La bonne tête de veau! L'exquise salade bien verte avec beaucoup de vinaigre! A ce régime-là, naturellement, la dysenterie arriva, réduisant à rien le corps délabré du malheureux qui jeûnait et souffrait depuis près de deux mois. La potion brésilienne, administrée deux fois, fit disparaître la dysenterie, mais laissa à la place la lente, la terrible diarrhée de Cochinchine, qui ronge les tempéraments les plus robustes, et qui a conduit au tombeau, lors de la conquête, cent fois plus de victimes que les balles…
Réunissant tout ce qui me restait d'énergie, je parvins à me faire embarquer à bord du courrier du 14 janvier. Le 8 février je débarquais à Marseille, le 9 j'étais admis d'urgence au Val de Grâce. Là, il a été reconnu par les chirurgiens — et ceux-ci savent leur métier — qu'une troisième opération est nécessaire : il reste à enlever encore 8 à 10 centimètres de fémur! Cette opération ne pourra être tentée que dans plusieurs mois, car mon état de faiblesse extrême ne permet pas d'y songer pour le moment
De tous les coins de la Cochinchine où je suis très connu, du Tonkin, de France, il m'est arrivé de nombreux témoignages de sympathie. Le Gouverneur lui-même a tenu à venir lui-même passer une heure auprès de mon lit d'hôpital. Le commandant de la Marine, le colonel de la Calle, les chefs de service sont venus, à plusieurs reprises, me serrer la main.
J'ai bien souffert! Je reste mutilé, privé du seul plaisir au monde que je m'accordais volontiers, la chasse. Mais je crois avoir fait mon Devoir!
Hector Placide Giat - 1894

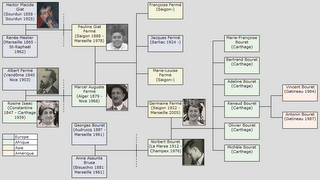
Aucun commentaire:
Publier un commentaire